On le trouve sur YouTube, et c’est heureux. Sous le titre de 6 et 12, Ahmed Bouanani a filmé, en 1968, le réveil de Casablanca. Sans paroles, les ruelles vides de la médina s’animent peu à peu de son « petit peuple », qui investit au fur et à mesure les avenues d’un centre-ville art déco rutilant, ou presque. Les trolleybus font leurs premières étincelles, tandis que les grandes artères sont nettoyées sous les réverbères encore allumés.
Au son d’un jazz d’avant-garde, les vagues battent les Roches Noires, les rails de chemin de fer s’élancent vers l’horizon, tandis que forains et grutiers du port huilent les rouages de leurs machines. Les terrasses des cafés ouvrent, alors que le ramassage des ordures croise les livreurs de lait et les écoliers encore ensommeillés. Mais ce sont le rock’n’roll du juke-box et les flippers des jeunes gens qui ouvrent le bal de la journée moderne, des perspectives décadrées de l’architecture des immeubles vertigineux, du flot de voitures et d’ouvriers…
Il est tout à fait remarquable que le montage d’Ahmed Bouanani rende, dès 68, un hommage appuyé au désormais célèbre L’Homme à la caméra tourné par Dziga Vertov en 1929, à Kiev, Moscou et Odessa, notamment. Le documentaire de Vertov fut méprisé à sa sortie, tant par Eisenstein que par le New York Times de l’époque. Il a fallu attendre 1983 et, surtout, les années 90 pour que ce chef-d’œuvre de cinéma expérimental — revendiqué — prenne la place qu’il mérite dans le panthéon de la critique internationale.
Avec le recul, il est évident que cet Homme à la caméra invente et met en place beaucoup des moyens que va finalement adopter toute l’industrie cinématographique : ralenti, accéléré, surimpression, gel d’image, mise en abyme, etc. Il s’agissait aussi de libérer le cinéma de la littérature et du théâtre. Et puis cette idée, tellement loufoque, de ce qu’une caméra pourrait aller partout, jusque dans l’intimité…
Les années 2000 ont vu des projections de ces images à la gloire de la révolution prolétarienne et de l’industrialisation triomphante dans tous les festivals universitaires d’Europe et des USA. Bouanani, lui, n’avait pas attendu. Après tout, il fut aussi un acteur de la revue Souffles, et faisait très volontairement un lien entre l’espoir révolutionnaire et la naissance de la culture du Maroc indépendant. On ne disait pas encore « post-colonial ».
Vertov célèbre librement — les commissaires politiques ne sévissaient pas encore sur son art — une vie nouvelle conduisant les courageux travailleurs vers le bonheur de sains loisirs sportifs sur les plages de la mer Noire. Bouanani, lui, prend plus de distance. L’heure du repas au restaurant, sur un air James-Brownien, est entrecoupée de plans des animaux du zoo. Par le jeu du montage, lions et gorilles encagés se mêlent aux figures des employés de bureau mastiquant la nourriture que leur jettent les gardiens, euh…, les garçons.
Lors d’une projection de 6 et 12, à Casablanca au milieu des années 2000, de jeunes étudiants furent dérangés par ces images et interrogèrent, fort poliment, le réalisateur Ali Essafi pendant la conférence qui a suivi. Comment pouvait-on se moquer ainsi d’une accession à la modernité si cher payée ? La réponse se trouve peut-être dans L’Hôpital, l’un des trop rares textes publiés d’Ahmed Bouanani.
Si l’auteur ne fut hospitalisé que pour une tuberculose, le narrateur du roman nous décrit une institution passablement kafkaïenne, où des malades mentaux se pensent tels puisque leurs infirmiers le leur répètent, du haut de l’autorité conférée par le port de la blouse blanche. Ainsi :
« Prisonnier de l’hôpital ou de mon corps, démuni de tout, même de ma mémoire où pourtant j’avais le pouvoir de pétrir mon argile à volonté dans le sang des astres et des légendes et dans la saveur à goût de mille printemps et de doux hivers des chants et comptines désormais enfouis dans des sillons secrets, je dormais et m’éveillais avec d’effroyables sensations d’inconsistance et d’angoisse ou de déchirement, ne disposant plus de fil logique, et mes chutes dans les fondrières du jour et de la nuit répétaient cruellement l’image caricaturale, l’image manquée d’une victoire et d’une liberté. »
À la demande de la ville de Porto, qui fut capitale européenne de la culture en 2001, le groupe Cinematic Orchestra, mêlant hip-hop, jazz et électro et qui est issu du très avant-gardiste label britannique Ninja Tunes, a composé une musique pour accompagner, live, des projections du film muet de Dziga Vertov. The Man with a movie camera, son titre anglais, entrait définitivement dans la légende et Cinematic Orchestra nous a donné plusieurs versions d’un de son morceau, Evolution.
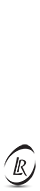
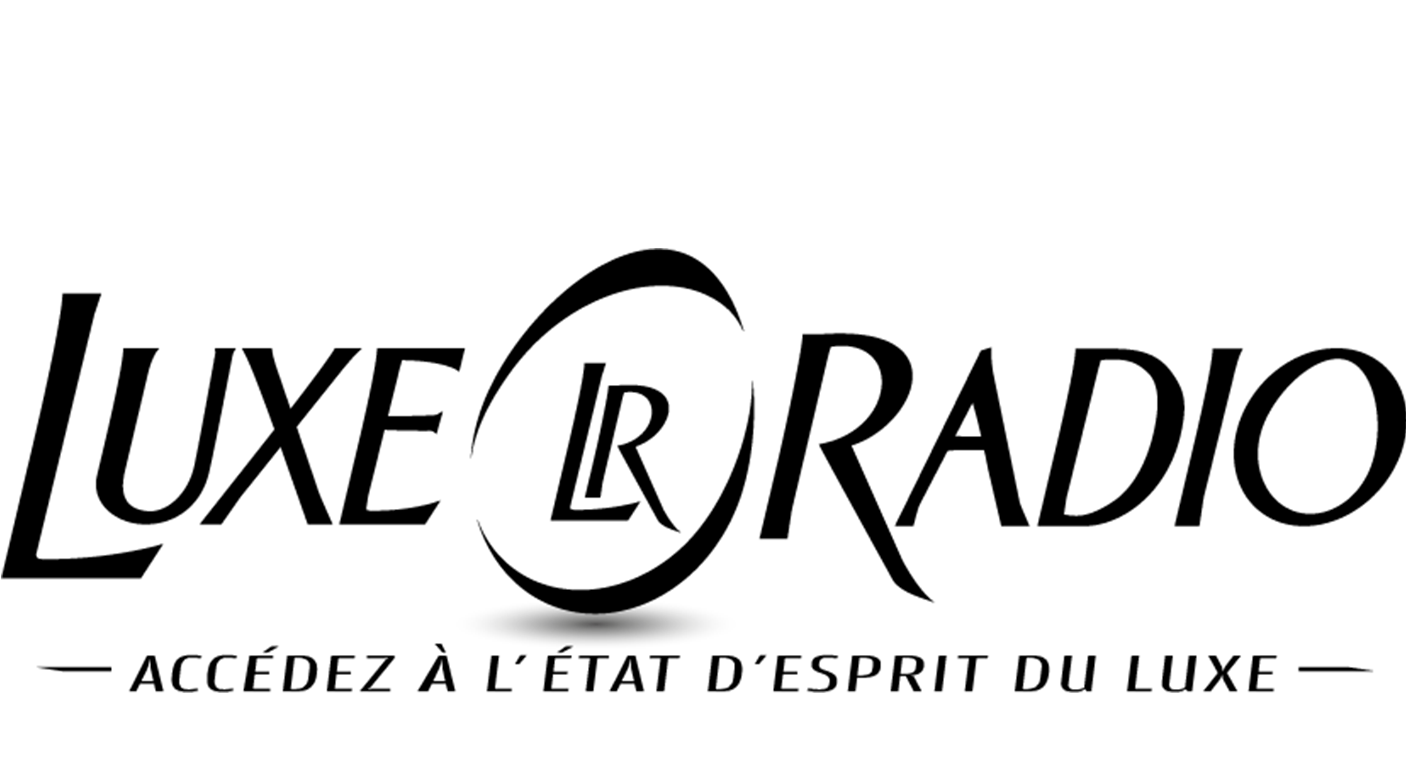


 Éloge de l’impur
Éloge de l’impur Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature »
Cri d’alarme des scientifiques : « repenser une civilisation où l’Homme est responsable de la nature » Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ?
Sur internet, la liberté d’expression ou la liberté d’impression psychologique ? Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Vente d’esclaves en Libye : « vieux réflexe de l’archaïsme violent » selon Driss Jaydane
Poster un Commentaire